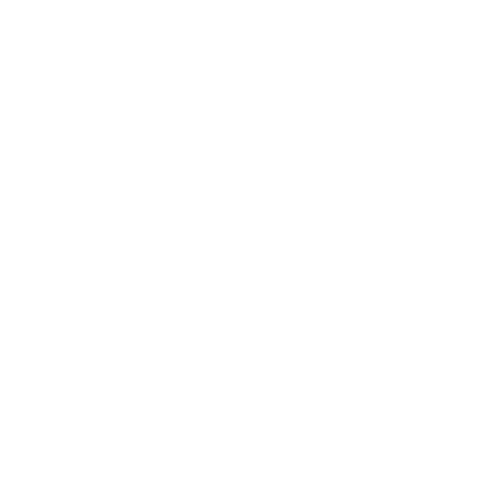Chantal Fortier
Le temps creux
Aline jaugeait la quantité de liquide dans sa seringue. Les rayons du matin traversaient le cylindre qu’elle tenait à la verticale entre ses doigts fins. Son pouce enfonça légèrement le piston, une fontaine minuscule jaillit en contre-jour. J’étais éblouie par ce rituel qu’elle exécutait avec minutie et exactitude. Le protocole, c’est le protocole, disait-elle en un enchaînement de gestes qu’elle terminait toujours par un bref coup de phalange sur le tube. Le point final avant l’injection. Comme ça, on peut être certain qu’il n’y a plus de bulles d’air. La tubulure avançait en dos de chenille dans la fente de la pompe millimétrique. Le soleil filtrait par les persiennes pendant que le traitement commençait sa partition.
Aline devenait ma mère, la remplaçait. Mais il m’était impossible de m’opposer à cette évidence ni de contester ses faits et gestes ; mon corps en dépendait. Le matin, ma débonnaire alchimiste arrivait en silence et déposait autour de moi son odeur et ses regards d’ange fatigué. Ses mouvements méthodiques s’accompagnaient de bruissements, de draps et d’étoffes, de glissements de tiroirs et d’instruments. C’est à son arrivée, souvent au terme d’une nuit blanche, que je me laissais gagner par cette valse programmée et m’endormais.
J’étais arrivée ici un vendredi soir d’avril. Tout ce que j’avais retenu, après l’inscription, l’admission et la déclaration d’assurance, c’est un insolite sentiment de dépossession. Devant la commis à l’inscription, j’ai déposé ma montre, mon portefeuille, mon téléphone portable. On allait les mettre dans un coffret de sécurité. Pour moi, le temps s’arrêtait là. Dorénavant, mon horaire allait se dilater et se désintégrer. Je vivrais comme dans un scaphandre. Je serais en apesanteur, flottant dans un autre monde. Métamorphosée. Déconnectée. Catastrophée, peut-être. Mesurée. Examinée. Chacune de mes manifestations biologiques marquerait les prochains jours de son bourdonnement singulier. J’entrais dans un sas.
Ma chambre, située au bout de l’unité de soins, est ceinte de larges fenêtres. La vue plonge au-dessus de la ville portuaire et, de là, mon impossible évasion renforce mon sentiment d’esseulement et d’abandon. Dans le meilleur des mondes, je me serais défenestrée, non pas pour mourir, mais pour survoler le ciel, échapper aux secondes, traverser les saisons et les époques. Ici, je perds tous mes repères. Il ne faut pas se laisser aller jeune fille, tu es jeune, une battante, et une battante est d’abord une combattante ! Moi, je veux juste dormir et qu’on me fiche la paix avec le judo et les luttes armées. Je dois m’habituer à mon noviciat dans la grande communauté des malades, et seul le renoncement m’apaise. À quoi bon, je glisse ! C’est dans ces conditions que je rencontre Aline, ma soignante, l’éclaireuse qui me relève plus d’une fois du gouffre. Je suis son éclopée de guerre, mon bras autour de son cou.
Ce matin, au large de Bali, à huit cents mètres de profondeur, un sous-marin se fracasse, pendant que moi, au dixième étage, entre des séances de radio, je dîne en regardant la ville. Cinquante-trois jeunes sous-mariniers ont perdu la vie, alors que je ne sais plus si je dois me battre pour la mienne. Seul le visage d’Aline m’émeut. Son regard de brebis égarée m’interdit tout chagrin que je pourrais lui causer en allant de plus en plus mal. Je lui redemande de l’Ensure® au chocolat pour que son visage s’illumine et qu’elle puisse enfin se retrouver dans le bordel de mes pansements souillés. Il m’arrive de penser qu’elle est ma mère, la vraie.
Je regarde la vidéo des sous-mariniers dans leur submersible. Confiants et heureux, ils chantent un au revoir à leur commandant. Je suis dans une autre dimension, celle de l’innocence, de l’appréhension et de l’effroi. Aline tourne autour du lit et s’affaire. On devrait interdire à YouTube de diffuser ce genre de vidéos. C’est bouleversant ! Ce n’est pas bon pour ta santé de penser à ces affaires-là ! Allez, mange un peu ! Je chipote ma nourriture, imagine les hommes du sous-marin, les poumons gonflés d’eau, leurs visages lunaires flottant sur la mer comme des bouées. Leur foi aveugle m’est insupportable.
Je repasse la vidéo en boucle pour les faire revivre, les ressusciter, reculer dans leur passé antérieur, les extraire de la mort, en repoussant mon plateau. Je n’ai pas faim. Aline est déçue. Elle ignore que, de tout cet été perdu, elle sera mon unique abeille, mon insecte piqueur, ma lumière du matin. Dans ma chambre de zinc et de néon, je la laisse butiner, préparer mon futur antérieur, essayant de m’extraire de la mort.
Mais la douleur, elle, n’est pas tuable. Je sonne, je réclame mes cachets. Un brancardier arrive pour ma tomodensitométrie. Je traverse l’hôpital en fauteuil roulant, parcours de longs couloirs saturés d’odeurs humaines et médicamenteuses.
La mort rampe sous le parfum des fleurs en aérosol.
On m’installe sur une civière. On allonge dans un tunnel mon corps, qu’une mécanique sophistiquée photographie tranche par tranche, en produisant des bruits futuristesd’ordinateur et de robot. Mon sous-marin, ma tombe, mon enfermement. Je n’ai ni guitare ni feu de camp pour chanter comme les sous-mariniers. Mais je pense à eux, à Aline, à ma mère qui m’emmène au parc, aux tunnels multicolores des jardins d’enfants, aux toboggans, au péril qui guette chacun, à la chute de la vie. Ma vie s’écroule et la machine tente de me reconstruire. L’ordinateur reconfigure mon corps, mes tumeurs sans exception, en images 3D. Mes premières photos de collation des grades.
Hier, au retour du travail, Aline s’est fait prendre par l’orage. Sans imper ni parapluie. Un vrai déluge ! Mes beaux souliers neufs, imagine, sont finis, F, I, N, I, finis ! Qu’est-ce que tu voulais que j’fasse ? Bah, j’me suis fait couler un bon bain chaud avec de la lavande, et chu restée là une bonne demi-heure. En sortant du bain, j’avais la peau toute fripée ! Même encore ce matin, regarde-moi ça ! J’étais désolée pour elle, mais secrètement ravie de son récit. J’imaginais le corps frigorifié d’Aline, submergé jusqu’aux oreilles, le regard à fleur d’eau, comme un nénuphar déposé entre des bulles d’air et de mousse qui crépitent. Aline est heureuse quand elle devient une plante aquatique.
Demain, quarante jours seront passés. Tu pourras recevoir ton congé si tes globules blancs répondent présents avec une bonne moyenne ! Je reste de marbre. J’avoue que je crains ce qui pourrait m’arriver, une chute de pression, une inflammation inattendue, un état de choc, mes globules à flots. Tout est possible. Me voici à la merci d’une réorganisation, d’un retour en mode normal, qui me laisse perplexe et sans force. Ma mission Deep Time[1] est complétée. Je dois sortir de ma grotte, abandonner Aline à ses seringues et à ses savates trempées, me protéger des rayons du soleil, m’enduire de crème, m’isoler à nouveau, me couvrir d’un chapeau, porter des verres fumés. Je serai libérée, extradée avec une prescription aussi détaillée qu’un rite funéraire.
Aline est lumineuse ; sa chevelure rousse rayonne au soleil. Je lui dis : désolée, moi, je reste. Comment lui avouer que cellule par cellule, de mes incontrôlables mitoses, j’avais trouvé le meilleur moyen de me faire aimer.
Je réclame de l’Ensure® au chocolat. Aline soupire. J’imagine tresser des coquelicots à ses cheveux.
Je mourrai vraiment si, un jour, Aline m’oublie.
[1] Deep Time est une expérience de confinement volontaire effectuée dans une grotte des Pyrénées où les participants sont coupés, pendant quarante jours, de tout contact avec le monde extérieur.
Après IV, mourir n’est pas une option
La journée était sur le point de se terminer. Je décidai de joindre André sur son téléavertisseur pour lui proposer mon aide. Au dîner, il avait semblé dépassé par sa charge. Comme c’était un vendredi, il aurait voulu finir tôt et que les choses soient simples. Il accepta donc mon offre. Il m’indiqua le nom d’une patiente, son numéro de chambre, et m’assura, sur un ton badin, que ce ne serait pas compliqué. Aussi, il me rafraîchit la mémoire au sujet du protocole postopératoire et des indications à suivre. Je notai tout ; en effet, ce serait facile. La semaine allait pouvoir finir en beauté. Nous nous souhaitâmes le meilleur, il ferait beau samedi, il fallait en profiter, deux jours de congé passent si vite.
Je n’étais pas pressée. Je n’avais rien de particulier à l’horaire. Je pouvais prendre mon temps. Je montai dans l’ascenseur, changeai de pavillon et me dirigeai vers l’étage où se trouvait la patiente que je devais aller voir. Au-delà des couloirs et des postes d’infirmières flottaient une tranquillité provisoire, un relâchement de l’agitation du personnel de jour, d’où je sentais sourdre l’angoisse. Celle des malades dans leur lit d’hôpital. Celle de l’impuissance universelle face à la mort, de la solitude qu’elle contient.
Chaque quart de travail représente à lui-même un monde. À cette unité de soins, celui du soir m’était étranger. Je repérai le dossier, lus l’histoire du cas : néoplasie du sein, tumorectomie, évidemment axillaire. Triangulation classique, cent fois observée, presque banale, assez courante en chirurgie générale. Je continuai de lire : jeune femme, multipare, trente ans, jour deux postopératoire. Après un instant d’arrêt, je fis le compte dans ma tête et me mis à relier le sens des informations du dossier. Il arrive que même les soignants n’y croient pas non plus, tellement cette maladie s’approprie tout avec arrogance.
Au bout du couloir, par une haute fenêtre, un soleil indécent éclaboussait tout, murs et planchers. Attirée par cette lumière tragique, je m’engageai dans le couloir avec une peur lâche. J’hésitai avant d’entrer, fis une pause, respirai. Un autre monde m’attendait. J’aperçus d’abord son pied nu qui dépassait et, sous les draps rabattus, le contour flou de son corps abandonné à l’attente. Elle fixait le mur, de possibles apparitions. Magnifique, elle en était bouleversante, blonde, bouclée, avec une peau rose d’enfant. J’étais à peine plus âgée qu’elle. On aurait dit une souveraine dans un lit de métal, l’acier même des guillotines. Sur la table de chevet, une photo, ses petites filles. À leur innocence se superposaient les visages de mes garçons.
Je me présentai à elle avec embarras. Son sourire tremblait, le mien aussi, peut-être. Nous nous taisions, laissant tomber toutes les conversations que nous aurions pu tenir, évaluant ce qui nous unissait. Comme on évalue la distance de marche entre deux points, sachant qu’il y aura une marge d’erreur. Ce que je possédais lui échappait. Les secondes avaient du plomb dans l’aile. La situation s’avérait injuste et je sentais ma présence terriblement inopportune. Immobile, je ne savais plus où me mettre.
J’approchai une chaise, m’assis à ses côtés. Je commençai à expliquer l’importance de la mobilité de son épaule, des limites à respecter tant que le drain ne serait pas retiré. J’entendais l’inutilité de ma voix, son silence et sa révolte. Des larmes apparurent sur ses joues. Je me tus. Et sa question tomba à mes pieds comme une pierre.
- As-tu des enfants, toi ?
Nos yeux scrutaient nos visages. Nous étions le tambour de l’une, le miroir de l’autre, et entre les deux, résonnaient l’espoir et le néant.
- Oui, j’ai deux garçons.
Et comme je devinais la suite, j’ajoutai qu’ils étaient du même âge en désignant la photo de ses filles.
Elle s’est mise à pleurer.
- J’veux pas les abandonner ! J’veux pas les laisser toutes seules ! Comprends-tu ?
Et ses yeux pleins de larmes brouillaient tout son visage et me tourmentaient entièrement. Les documents qui lui étaient destinés tombèrent par terre. Je les ramassai. Ce n’était pas le bon moment pour ça. J’étais, malgré moi, embarquée dans le char allégorique de sa malédiction ; je savais des choses qu’elle ne savait peut-être pas encore.
- Je sais que je vais mourir. Est-ce que tu le sais, toi ?
Le mot métastase me revint en mémoire comme une tache de goudron sur un os blanc. Stade IV. Le chiffre romain me coupa la respiration. Je souhaitais qu’on la délivre du boulier. J’avais honte. Même silencieuse, je lui mentais.
Je partis de l’hôpital, il faisait un noir d’encre. Dissoute en moi, son image restait omniprésente, la photo de ses filles, ses yeux désespérés. Dans l’autobus, je pleurai. Quand j’arrivai chez moi, mes garçons jouaient tranquillement.
Je les pris dans mes bras jusqu’à ce que ma douleur passe.